Que vaut le CDI intérimaire ?
Le 7 février 2017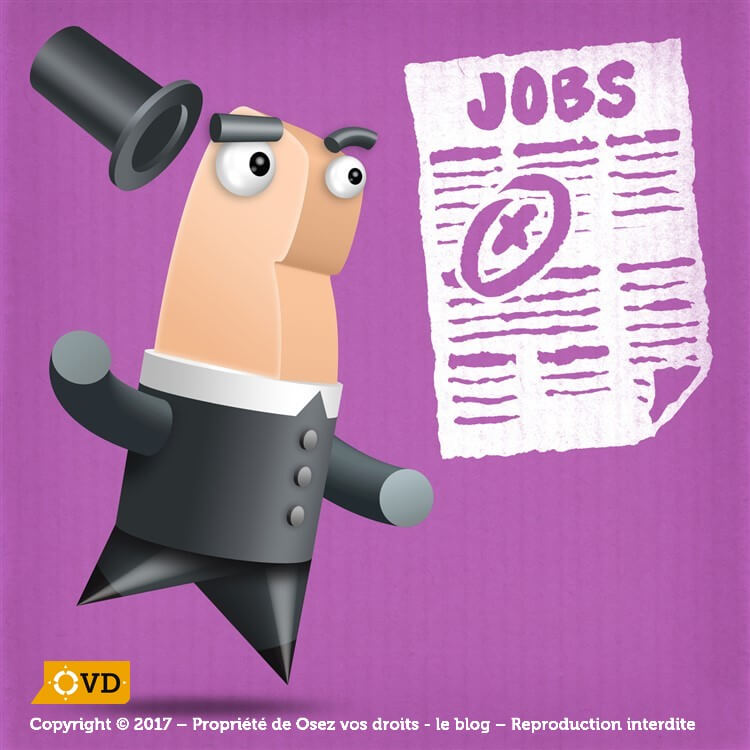
Produit d’un bricolage contre nature, le CDI intérimaire n’est pas sans rappeler la créature de Frankenstein. Est-il pour autant aussi peu séduisant que l’illustre monstre ? Avant de taxer le législateur de savant fou, penchons-nous en détail sur ce nouveau type de contrat…
Le CDI intérimaire : en quoi consiste-t-il ?
Ce drôle d’hybride est issu d’un accord collectif du 10 juillet 2013, étendu par arrêté du 22 février 2014 à l’ensemble de la branche du travail temporaire. La loi Rebsamen du 17 août 2015 est venue lui donner un fondement légal à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2018. L’accord et le texte de loi se complètent donc pour définir le régime du CDI intérimaire.
Ce contrat vise à créer une relation de travail permanente entre l’intérimaire et l’entreprise de travail temporaire.
Il prévoit donc l’alternance de périodes de mission et d’intermission. Durant ces périodes d’intermission, le salarié inoccupé doit demeurer à la disposition de l’agence d’intérim. Dans l’attente d’une nouvelle mission, cette dernière pourra décider de lui faire suivre une formation qualifiante (article 2.1 de l’accord du 10 juillet 2013). Cet engagement sur la durée est un gage de sécurité pour le salarié car celui-ci est assuré de se voir confier des missions et de percevoir une rémunération pendant ses périodes d’inactivité. Celui-ci bénéficiera également de véritables congés payés en lieu et place des périodes de chômage.
Aussi, il ne pourra librement mettre fin à cette relation puisqu’il devra pour ce faire démissionner ou solliciter une rupture conventionnelle. Enfin, l’intérimaire devra faire ses adieux aux fameuses indemnités de fin de mission ! Destinées à compenser la précarité inhérente au travail temporaire, celles-ci n’ont ici plus raison d’être.
À qui s’adresse le CDI intérimaire ?
Côté employeur, le CDI intérimaire s’adresse exclusivement aux agences d’intérim, titulaires d’un monopole en la matière (article L1251-3 du code du travail). Côté salarié, ce type de contrat est ouvert à tous et non aux seuls habitués des missions d’intérim. Les entreprises de travail temporaire se sont cependant engagées à donner la priorité aux intérimaires cumulant en leur sein 2 4000 heures de travail au cours des 24 derniers mois (article 2.2 de l’accord).
Que doit prévoir le CDI intérimaire ?
Le CDI intérimaire doit faire l’objet d’un écrit et contenir certaines mentions obligatoires visant à instituer certaines garanties pour le salarié (article 56 II de la loi du 17 août 2015). En premier lieu, il s’agit de définir le montant de la rémunération minimale garantie du salarié. Celle-ci ne peut être inférieure au montant du Smic sur la base d’une durée hebdomadaire de 35h00, majoré de 15% pour les agents de maîtrise et techniciens et de 25% pour les cadres. Mais le contrat va surtout définir le cadre dans lequel des missions pourront être confiées au salarié. Doivent ainsi être fixées les plages horaires pendant lesquelles celui-ci s’engage à rester joignable pendant les périodes d’intermission.
Le cas échéant, le contrat doit également préciser les conditions spécifiques liées à la durée du travail, notamment en cas de travail nocturne.
Le contrat doit également définir la zone géographique dans les limites de laquelle le salarié sera amené à effectuer des missions. L’accord du 10 juillet 2013 propose une zone de mobilité couvrant un trajet domicile lieu de travail de 50 km et un temps de transports en commun maximal de 1h30. Le contrat doit également prévoir le descriptif des emplois correspondant à sa qualification. En principe, cette liste ne saurait comporter plus de trois types de poste (article 2.4 de l’accord). Le contrat peut également prévoir une période d’essai dont la durée tiendra compte à la foi des périodes de mission et d’intermission et qui ne pourra être rompue qu’en cours de mission.
Rappel de l'Expert
Cette ancienneté est calculée sur la durée des missions exécutées lors des 12 derniers mois et est portée à 6 mois pour les agents de maîtrise et techniciens et 8 mois pour les cadres (article 2.3 de l’accord).
Comment se déroule l’exécution du CDI intérimaire ?
L’une des principales contraintes du CDI intérimaire est que le salarié a l’obligation d’accepter les missions ou formations professionnelles proposées. Des garanties sont toutefois prévues. Ainsi, le salarié pourra refuser une mission non conforme au cadre fixé par le contrat ou prévoyant un taux horaire inférieur d’au moins 70% à celui de la mission précédente. Au cas où le salarié accepterait malgré tout une telle mission, il aura la possibilité de l’interrompre pendant une période dite probatoire. Cette période de 2 jours est portée à 3 jours pour une mission de plus de un mois et à 5 jours pour une mission de plus de 2 mois (article 3.2 de l’accord).
L’entreprise de travail temporaire a l’obligation de remettre au salarié une lettre de mission pour chaque mission confiée. Pour chaque mission, l’intérimaire ne pourra être rémunéré en deçà du salaire que percevrait un salarié de l’entreprise utilisatrice sur le même poste (article 4.1 et 4.2 de l’accord). La durée maximum d’une mission est de 36 mois, contre 18 pour une mission d’intérim classique.
Lors des périodes d’intermission, le salarié ne perçoit pas forcément de rémunération.
L’agence d’intérim devra simplement s’assurer qu’il a perçu la rémunération minimale garantie par son contrat. Ces périodes d’inactivité seront toutefois comptées comme temps de travail à raison de 7 heures par jour et prise en compte, notamment, au titre du calcul de l’ancienneté et des congés payés. En cas d’appel pour une mission, il est tenu de se rendre dans l’entreprise utilisatrice dans un délai minimum d’une demi-journée.
Finalement, que vaut le CDI intérimaire ?
Plus sécurisant mais également plus contraignant que l’intérim classique, le dispositif peut séduire les précaires à la recherche d’une plus grande stabilité. Chacun y trouvera ou non son compte, selon qu’il privilégie liberté ou sécurité. Un avis plus objectif pourrait être rendu en l’évaluant au regard des objectifs poursuivis lors de sa création. Or, le problème réside dans le flou entourant les motifs qui ont présidé à sa mise en place. L’accord du 10 juillet 2013 visait une meilleure insertion vers l’emploi durable. De ce point de vue, le CDI intérimaire n’est guère plus qu’un pis-aller.
Avis de l'auteur
Selon l’organisation Prism’Emploi, l’objectif quantitatif de 20 000 CDI intérimaires en 2017 serait en passe d’être atteint. Reste à voir si le législateur décidera de pérenniser le dispositif au-delà de la date butoir du 31 décembre 2018. Un rapport ministériel devrait être rendu au plus tard le 30 juin 2018 (article 58 de la loi).
